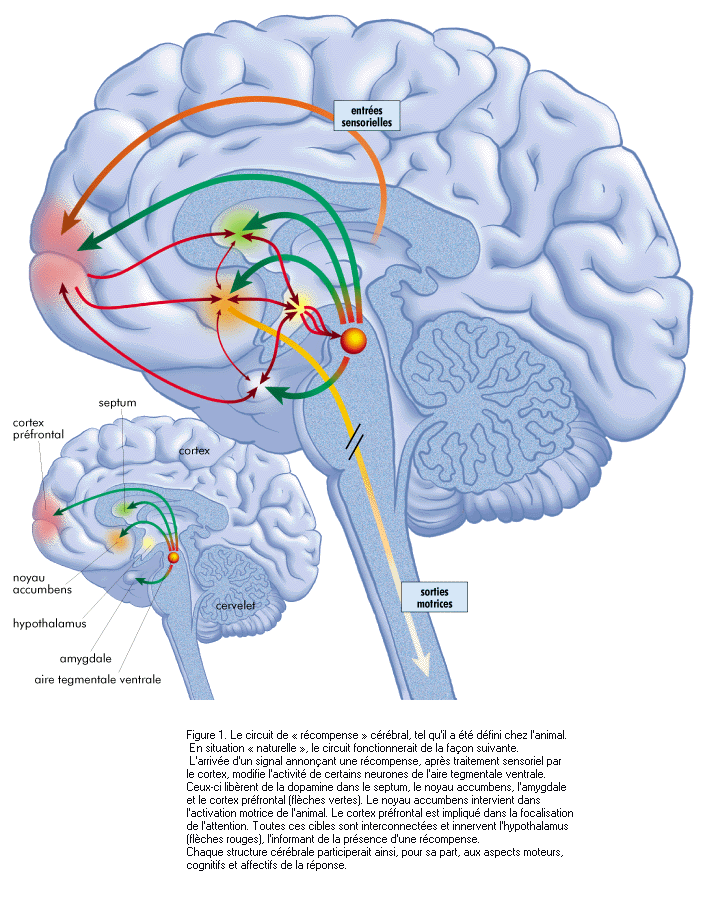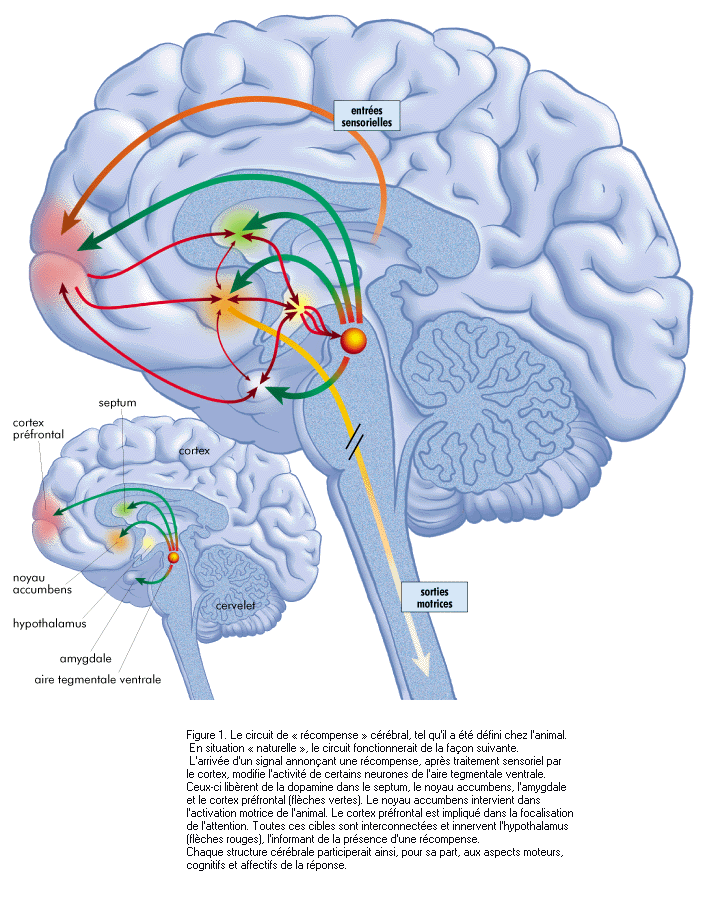
Drogues, dépendance et dopamine
On a longtemps lié l'installation de la dépendance, chez le toxicomane, à ce qu'il est convenu d'appeler le système de récompense. Il est désormais établi que tous les produits qui déclenchent la dépendance chez l'homme augmentent la libération d'un neuromédiateur, la dopamine, dans une zone précise du cerveau. Il est vraisemblable que l'installation de la dépendance soit due à la modification, par la drogue, de la cinétique et de l'amplitude de cette production de dopamine.
…
Drogues, plaisir et douleur
Cocaïne, ecstasy, tabac, alcool, morphine... Tous les produits qui déclenchent une dépendance chez l'homme ont en commun une propriété : ils augmentent la quantité de dopamine disponible dans une zone du " circuit de récompense " du cerveau, le noyau accumbens. Beaucoup de drogues agissent au niveau de la zone de connexion, ou synapse, entre le neurone libérant la dopamine et le neurone cible (voir figure). La cocaïne (et le crack) bloquent la recapture de dopamine par le neurone émetteur. L'amphétamine et ses dérivés, comme l'ecstasy, agissent à deux niveaux : ils bloquent la recapture de dopamine et, dans le même temps, augmentent sa libération. La fumée du tabac agit de deux manières. D'une part, elle stimule l'activité des neurones émetteurs, par le biais des récepteurs nicotiniques présents sur ces neurones. D'autre part, elle empêche la destruction de la dopamine en bloquant le fonctionnement de l'enzyme monoamine oxydase. L'alcool diminue aussi l'activité de cette enzyme. Le cannabis entraîne, quant à lui, une faible libération de dopamine selon un mécanisme encore discuté(20,21).
Le cas des opiacés, comme la morphine et l'héroïne, est un peu particulier. En 1992, S. Johnson et R. North, de l'université d'Oregon à Portland, ont montré comment ces substances activent également les neurones libérant la dopamine, mais de façon indirecte(22).
Les opiacés exercent leur action sur des neurones qui, eux-mêmes, ont pour effet de diminuer l'activité des neurones libérant la dopamine. En se fixant sur des récepteurs portés par ces neurones intermédiaires, les opiacés diminuent leur activité. Ce qui revient, au bout du compte, à augmenter celle des neurones qui libèrent la dopamine.
La morphine ou l'héroïne sont aussi connues pour leurs propriétés analgésiques. Cette double caractéristique pourrait faire penser qu'il existe un lien physiologique entre le plaisir et la douleur.
En fait, ce lien vient de ce que les mêmes récepteurs (baptisés m-opiacés) existent aussi dans la moelle épinière, où ils inhibent la transmission du message douloureux. Les symptômes de dépendance physique, observés lors du sevrage aux opiacés, sont dus au manque de stimulation de ces récepteurs dans la moelle épinière et dans le bulbe rachidien. Ils sont donc sans rapport avec l'effet euphorisant de la drogue.
Extrait de l'article dans La Recherche
du 01/02/1998
Auteur : JEAN-POL TASSIN
directeur de recherche à l'Inserm.
Il dirige un groupe de recherche au sein de la chaire de Neuropharmacologie du Collège de France, à Paris.